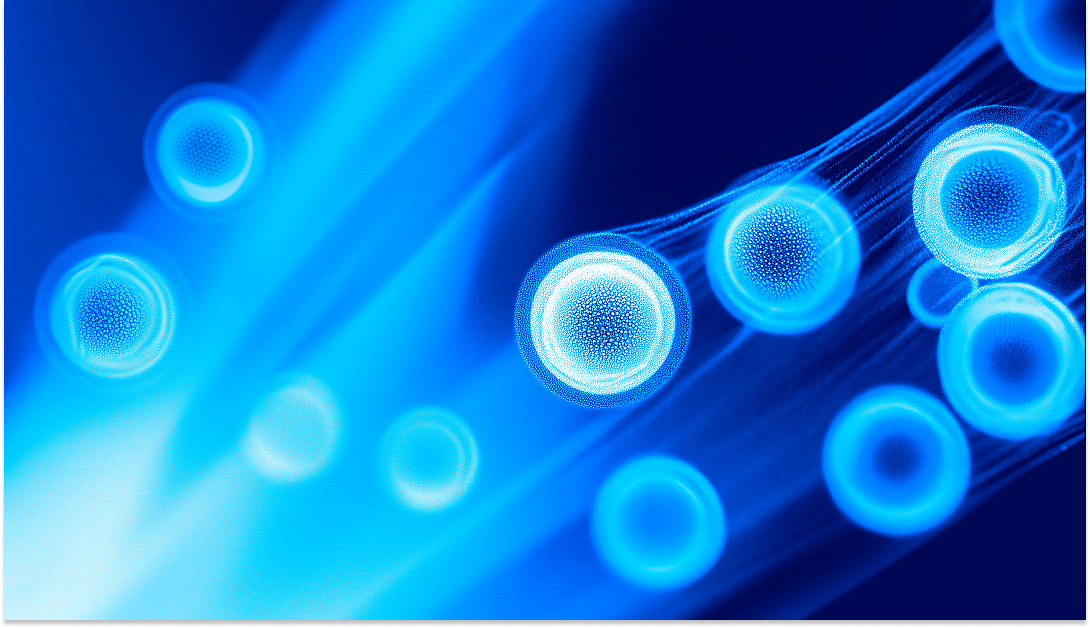Cibler l’invisible : Lindsey Rodrigues face à la complexité de l’épigénétique
« Il peut y avoir un gène dérégulé ou muté dans un cancer particulier. Nous devons nous demander : comprenons-nous comment fonctionne ce gène ? Pouvons-nous concevoir un médicament pour le traiter ou le cibler ? »
Lindsey Rodrigues travaille dans le domaine de la recherche, bien avant que les molécules n’arrivent en clinique. Son domaine concerne les cas où les cellules cancéreuses sont reprogrammées au niveau de l’expression génique, et non par mutation génétique. « Il y a ces protéines responsables de la lecture, de l’écriture et de l’effacement des marques épigénétiques », dit-elle. « Et cela contrôle si un gène est activé ou désactivé. On ne peut pas les voir avec les outils traditionnels. C’est ce qui rend cela si intéressant. »
Chez Ipsen, elle dirige la stratégie biologique des programmes épigénétiques en phase précoce et soutient les équipes d’innovation externe dans l’évaluation d’actifs potentiels à ajouter au pipeline d’Ipsen. « Vous pouvez avoir deux molécules avec des données similaires », dit-elle, « mais des mécanismes très différents. Nous nous demandons : est-ce sélectif ? Cela atteint-il la bonne cible ? Comprenons-nous la population de patients ? »
Son parcours en oncologie académique guide cette analyse. Elle s’est formée en microfluidique, biologie de l’ARN et criblage CRISPR—utilisé pour mener des expériences à grande échelle montrant comment les gènes influencent un trait, une maladie ou le comportement d’une cellule. « J’essaie de trouver quelque chose de concret dans les données », dit-elle. « Surtout quelque chose de robuste. »
Lindsey considère l’épigénétique comme un domaine où de bonnes idées échouent souvent à se traduire. « C’est une cible mouvante », dit-elle. « Elles dépendent du contexte. Elles peuvent fonctionner dans une lignée cellulaire mais pas chez un patient, et la population de patients peut être plus restreinte que ce que le promoteur pensait au départ. »
Pour elle, cela rend la science plus urgente, pas moins. « Il y a tellement d’échecs », dit-elle. « Mais si quelque chose fonctionne, c’est puissant. »
Son équipe travaille de manière transversale dès le début, en engageant chimie, clinique et développement pharmaceutique pour évaluer ce dont un composé aurait besoin pour réussir. « Nous ne travaillons pas en vase clos », dit-elle. « Nous avons besoin d’apports à tous les niveaux. » Cette pression collaborative la garde concentrée. « Nous nous demandons : est-ce un projet dont nous serions tous fiers de faire partie ? Est-ce un traitement que nous aimerions que nos familles reçoivent ? » Ces questions la poussent, elle et son équipe, jusqu’à la ligne d’arrivée de la découverte, en contribuant au rôle plus large du développement de médicaments.